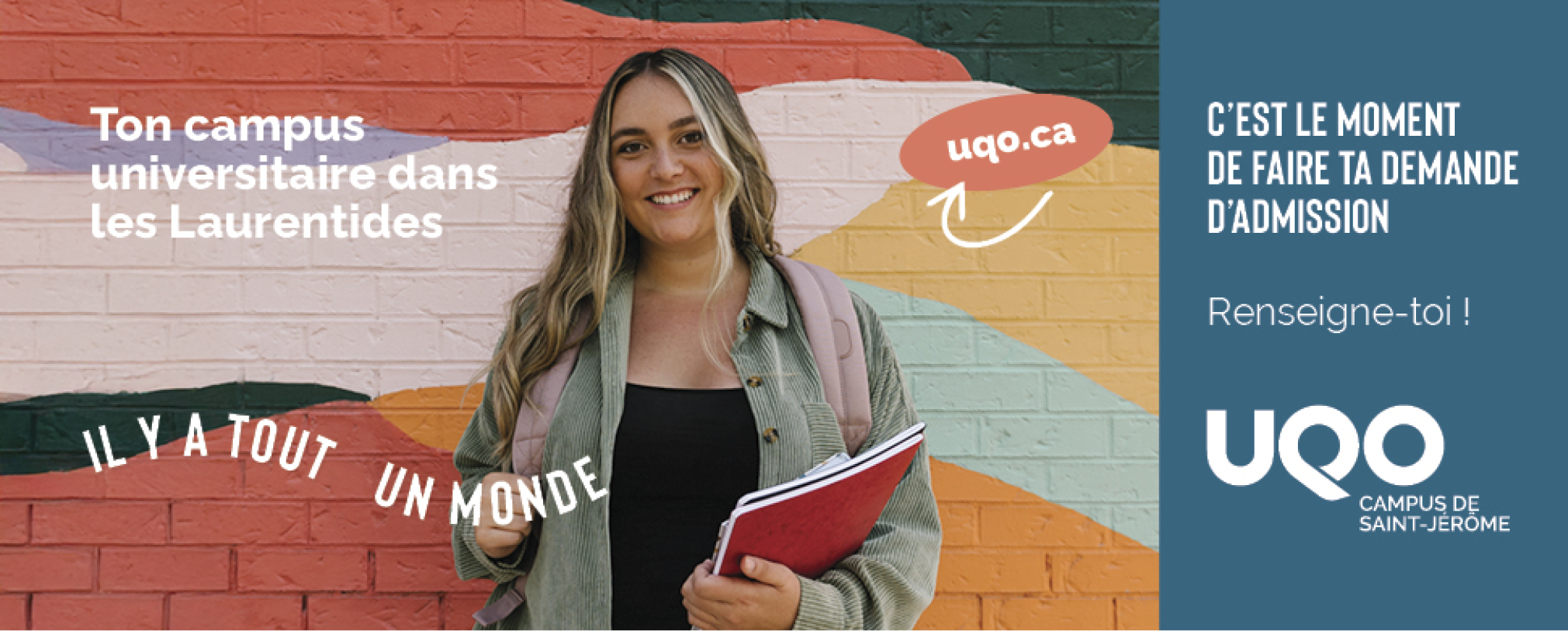Les vaccins, expliqués
Par Simon Cordeau
Avec l’annonce de nouveaux vaccins prometteurs pour combattre la COVID-19, nous nous sommes entretenus avec Dr Jean-Luc Grenier, médecin conseil à la direction de la santé publique des Laurentides.
Dr Grenier nous explique l’importance des vaccins comme armes contre les maladies. « On simule une infection pour amener une réponse et une mémoire immunitaires, sans avoir le problème de l’infection. » Pour ce faire, on utilise un leurre, et il y en a plusieurs types.
Pour les vaccins les plus simples, contre la coqueluche par exemple, on multiplie le microbe en laboratoire, on le tue, et on l’injecte. « Le système immunitaire rencontre des morceaux de coqueluche et se bâtit une réponse immunitaire. Donc quand on rencontre le vrai agent agresseur, on est prêt à le combattre. »
Toutefois, cela ne fonctionne pas pour toutes les infections. Ainsi il existe aussi des vaccins « vivants ». Dr Grenier donne l’exemple de la rougeole. « Le virus est vivant, mais on parvient à l’atténuer, à l’affaiblir. On crée une mini-infection, mais elle prend du temps à se développer et elle n’est pas dangereuse. Donc le système immunitaire a le temps de bâtir une réponse. »
Enfin, il y a des vaccins qui utilisent le génie génétique, par exemple ceux contre l’hépatite B ou le virus du papillome humain (VPH). « On introduit dans une levure, qui est une cellule vivante, un petit bout d’ADN du virus : le bout qui code la coquille, l’enveloppe du virus. La levure se met à pondre des milliards de coquilles vides, et on les ramasse, pour les injecter ensuite. » Pour le système immunitaire, la surface de la coquille est parfaitement identique au vrai virus. Il produit ainsi des anticorps qui serviront tant pour les coquilles inertes que pour le réel envahisseur.
Dans tous les cas, l’objectif est de faire croire au système immunitaire qu’il y a une infection, pour le mettre sur un pied d’alerte et pour qu’il garde en mémoire une défense contre l’agresseur.
Un vaccin ARN
Une partie du travail était déjà amorcée pour le vaccin contre la COVID-19. Durant l’épidémie de SRAS en 2003, les chercheurs avaient développé des prototypes de vaccin, mais la maladie a disparu avant qu’on n’en ait besoin. Le SRAS, comme la COVID-19, est un coronavirus. Il a donc été « relativement facile » d’adapter le travail déjà fait au nouveau virus.
Cela dit, la technique utilisée dans le vaccin de Pfizer est totalement nouvelle. « Ça fait longtemps que la théorie, que cette idée-là existe, mais elle n’avait pas été appliquée. » Le vaccin ARN, comme on l’appelle, utilise un autre virus, que Dr Grenier décrit comme rhume très banal, dans lequel on introduit une partie du génome de la COVID. « Le virus va avoir des petites pattes identiques à la COVID. »
Le virus va ensuite infecter des cellules humaines. « On amène nos cellules humaines à fabriquer des pattes de COVID, qui sont inoffensives en soi. Notre système immunitaire fait des anticorps pour s’en débarrasser. Donc quand il rencontre le vrai virus, il est déjà outillé pour le combattre. »
Les défis de la vaccination
Avoir un vaccin efficace est une chose, mais vacciner la population est un tout autre défi. Par exemple, le vaccin de Pfizer est vivant et il doit être congelé à -80ºC : un « casse-tête » pour sa distribution. Il requiert également deux doses, ce qui soulève nombre de questions. Quel intervalle doit-il y avoir entre les deux doses pour la meilleure efficacité? Comment s’assurer que tous ont reçu leur seconde dose? Sera-t-il mieux de vacciner le plus de gens possible avec une seule dose ou, pour avoir une bonne efficacité, il faut absolument deux doses? Dr Grenier rappelle que, à ce stade-ci, il nous manque encore beaucoup d’information pour prendre ces décisions.
Il y aura également plusieurs vaccins, chacun avec ses avantages et ses désavantages au niveau de leur efficacité, de leur production et de leur distribution. « Les santés publiques devront se demander : OK, on utilise quel vaccin pour vacciner quel groupe? »
Nous ne savons pas non plus combien de temps durera l’immunité créée par le vaccin. « Ce n’est pas écrit dans la recette du vaccin. C’est en observant les gens qu’on va le savoir. » Et cela peut prendre un suivi d’un an, de deux ans, voire plus.
Cela inquiète toutefois moins Dr Grenier. Habituellement, les vaccins confèrent une immunité beaucoup plus importante que l’infection elle-même. Il donne l’exemple du VPH. « L’infection ne confère à peu près aucune immunité. Mais le vaccin est extraordinairement efficace. Une dose est suffisante pour être complètement immunisé, et quasiment à vie! »