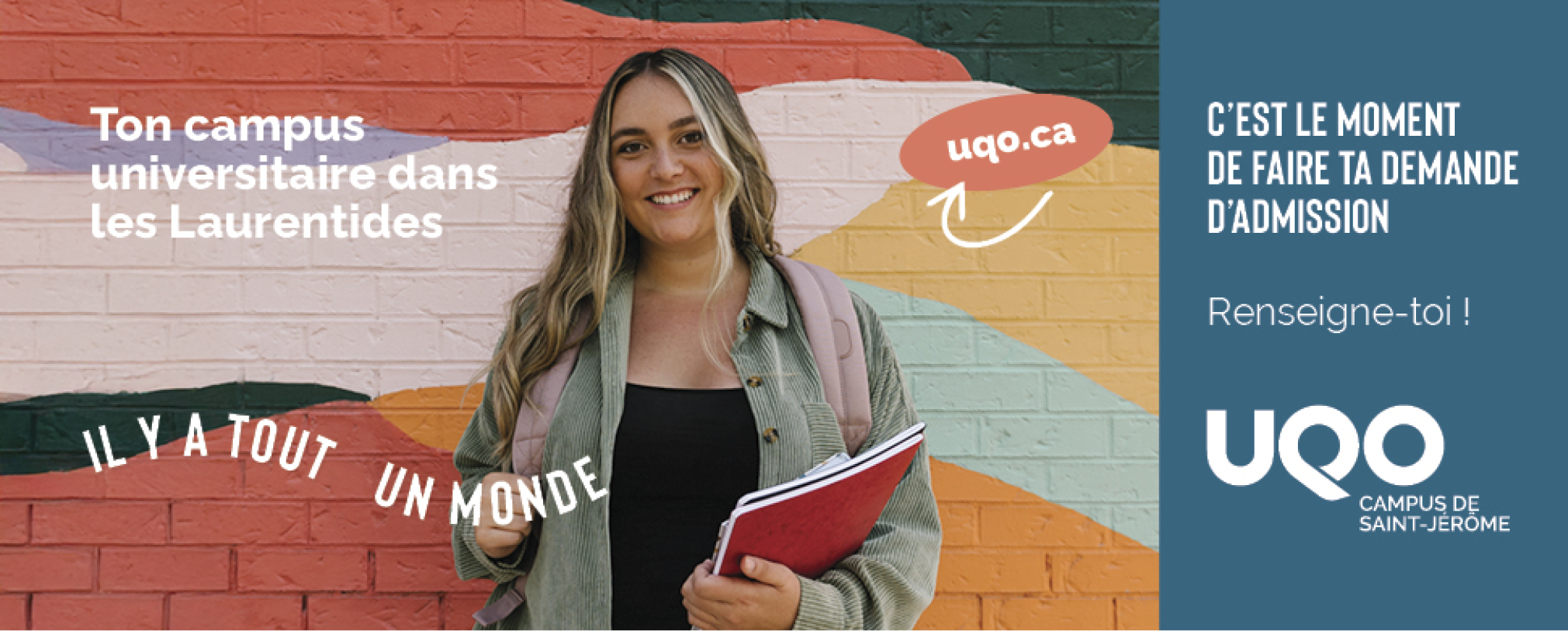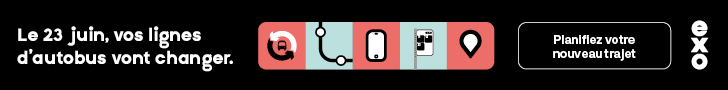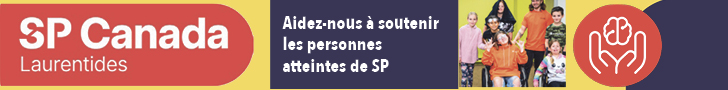Accepter sa différence : un processus jamais terminé
Par Simon Cordeau
Que l’on soit gai, lesbienne, trans ou non-binaire, être différent de la majorité comporte son lot de défis. Mais accepter cette différence en nous est le premier de ces défis, et peut-être le plus long à surmonter. Discussion avec Nicolas Courcy, coordonnataire des services LGBTQIA2S+ au Dispensaire de Saint-Jérôme et personne non-binaire.
Pour expliquer le processus d’acceptation, iel se base sur le modèle d’identité de Cass. Cependant, ce modèle date de 1979. « Avec ce que j’observe dans mon travail, je l’ai modifié un peu. On l’a modernisé. » Comme pour le deuil, ces étapes peuvent être vécues dans l’ordre ou dans le désordre, rappelle Nicolas. « C’est un processus individuel. » Le processus peut aussi s’appliquer aux personnes sur le spectre de l’autisme, TDAH, en situation de handicap ou immigrante, précise-t-iel.
La confusion
La première étape, c’est la confusion de l’identité. « Pour nous, c’est plus l’étape du choc. Tu es exposé au fait que tu fais partie de la minorité », précise Nicolas. Cela vient souvent avec un peu de déni, ajoute-t-iel. « C’est rare que tu vas accueillir ça à bras ouverts. Ça vient avec des enjeux sociaux, des dévoilements, parfois du rejet social et des violences systémiques. Ça peut faire peur au début. »
Ce déni entraîne un refoulement des émotions et un refus de s’informer sur le sujet. Nicolas donne d’exemple de quelqu’un qui tombe amoureux d’une personne du même sexe pour la première fois. « Tu vas te demander : « Comment ça ? Pourquoi moi ? Pourquoi je vis ça, et pourquoi je ne peux pas être comme les autres ? » Tu essaies d’éviter la question. »
L’acceptation
Malgré le déni, cette confusion de l’identité va « prendre beaucoup de place, beaucoup d’espace mental ». C’est l’étape de l’enracinement. « Ça peut devenir envahissant. C’est comme un ballon qu’on essaie de garder sous l’eau, mais qui essaie toujours de faire surface. Ça finit toujours par revenir », illustre Nicolas.
Durant cette étape, les personnes peuvent être plus vulnérables aux formes de discrimination. Mais elles peuvent aussi passer par une étape d’exploration et d’expérimentation. « Elles vont s’informer sur le sujet, communiquer avec des gens qui vivent la même chose. Ça vient normaliser et valider comment elles vont se sentir. Avant ça, c’est très abstrait. Mais l’exploration vient confirmer des choses. »
Après cette étape vient l’acceptation. « Je reconnais secrètement que c’est mon cas. Ça vient avec un lâcher-prise, un arrêt d’être qui on n’est pas. C’est accepter qui on est vraiment, et l’approvisionner d’un jour à l’autre », explique Nicolas.
Vient ensuite l’étape de la fierté. « C’est un balancier. Plus tu as eu honte de ta réalité, plus tu vas en être fier maintenant. Mais si tu étais dans un contexte où la diversité est validée, tu auras moins besoin de le crier sur les toits. »
La sortie
Après l’acceptation intime de sa différence, les murs entre soi et les autres peuvent tomber. On peut vouloir partager son secret avec des premières personnes, puis avec ses proches. Cependant, « la notion de contexte va vraiment influencer comment ça se passer. Si quelqu’un vient d’un milieu très croyant ou qui n’est pas ouvert à cette diversité-là, ça va être plus difficile », illustre Nicolas. C’est pourquoi il existe une « migration LGBT », où les personnes appartenant aux minorités vont partir des régions éloignées pour aller vers les grands centres, où il y a généralement plus d’acception, explique-t-iel.
Par ailleurs, « il ne faut pas prendre pour acquis, quand il y a une personne trans ou autre dans dans une famille, que s’il y en a une deuxième, ça va bien se passer », avertit Nicolas. Selon son expérience, certains parents acceptent mal d’apprendre que leurs deux enfants sont homosexuels, par exemple. « Donc l’expérience peut être vraiment différente au sein d’une même fratrie. »
« Quand ton enfant te dévoile qu’elle est trans, homosexuelle ou polyamoureuse, ça se peut aussi que tu ne connaisses pas ça. Tu peux avoir peur qu’elle vive des violences ou du rejet. Il peut y avoir des questions qui sont invalidantes pour la personne, également », prévient-iel.
D’où l’importance de parler des différences dans les médias et dans les cours de sexualité, soutient Nicolas. « Ça peut faciliter l’ouverture, et la personne sera plus confortable d’en parler plus rapidement. » Iel ajoute que le contexte du Québec, avec la Charte qui garantit le droit à la différence et prévient la discrimination, facilite aussi la situation.
La communauté
Toutefois, certaines personnes vivront des violences de la part de leurs proches lorsqu’elles sortiront du placard, qu’elles soient invalidées dans leur expérience, rejetées complètement, voire victimes de violence verbale. « C’est là que la communauté prend tout son sens. C’est pour ça qu’il y a des milieux queers et des « safe space ». Parce qu’il y a des gens qui, malheureusement, vont devoir se départir de leur famille biologique pour se créer une famille choisie », illustre Nicolas.
Ces milieux sont importants pour socialiser avec des personnes qui vivent la même chose, obtenir du soutien, et créer des liens, ajoute-t-iel.
L’intégration
Enfin vient l’étape de la synthèse, ou de l’intégration, de l’identité. « La différence fait partie de mon identité, mais ce n’est pas ça qui me définit. Il y a aussi mes hobbies, mon travail, mon rôle familial, comment je m’habille, etc. », explique Nicolas.
Ainsi, la personne demeure fière de sa différence, mais cette différence ne prendra pas toute la place. « Avant le « coming out », c’est comme si on retenait notre souffle. Donc quand on commence à respirer, on est comme essoufflé. On respire fort. Éventuellement, la respiration va revenir calme, posée », illustre-t-iel.
Cependant, ce processus n’est jamais terminé, rappelle Nicolas. Différents contextes, comme un nouveau travail ou une nouvelle école, peut nous ramener à des étapes précédentes. « Si je vais aux États-Unis aujourd’hui, ça se peut que je retourne dans la placard », illustre la personne non-binaire.